(Cet article est publié pour la première fois dans le livre collectif La francophonie haïtienne et la francophonie internationale : apports d’Haïti et du français haïtien, sous la direction de Renauld Govain, éd. JEBCA, octobre 2021.)
1. Introduction
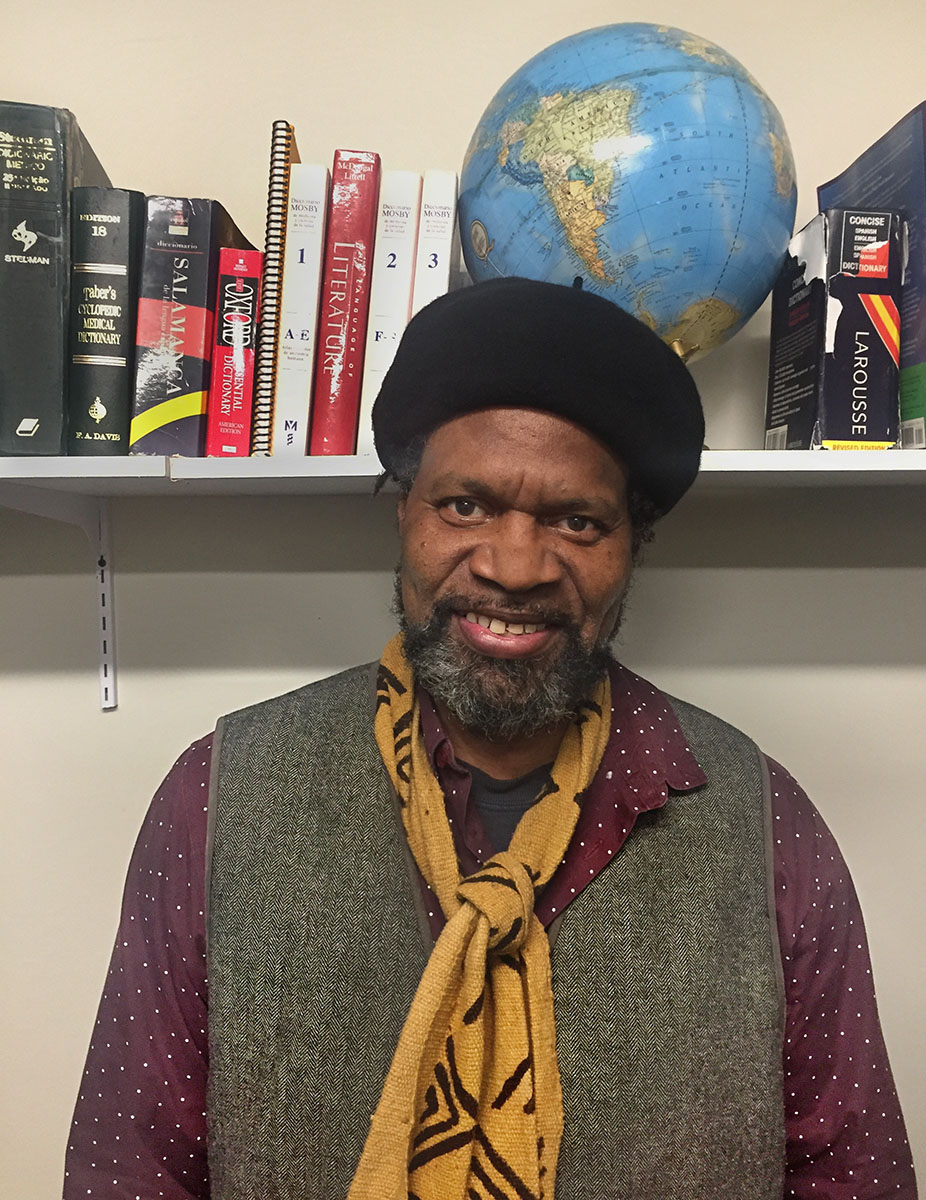
Tontongi à Cambridge, MA, en septembre 2021 —photo Tanbou.
Je ne pourrais écrire le présent texte qu’après la parution de mon livre Critique de la francophonie haïtienne, publié en 2007, parce que la distance du temps m’a permis d’évaluer la vérification des idées que j’y ai exposées à la lueur de la réalité empirique. Dans ce sens, le présent texte est une sorte d’épilogue à ce livre. Un épilogue que je titrerais « La persistance des préjugés mal-pensés contre le créole haïtien », d’après la traduction française d’un chapitre de mon dernier livre d’essais en créole haïtien (Tontongi, 2014: 135).
Comme le titre suggère, j’y énumère toute une série d’habitudes et de comportements, conscients et inconscients, de la part des locuteurs haïtiens qui continuent à recaler le créole haïtien dans un statut inférieur par rapport au français ou à l’anglais. Parmi les points mis à l’index se trouve la continuelle expérience de préjugés vécus par l’Haïtien et l’Haïtienne dans leur relation avec les institutions respectées comme l’administration de l’État, l’école, l’église, l’édition, le commerce, etc.
Citons ce passage d’un intertitre du chapitre en question qui traite des « préjugés contre la légitimité du créole » observés dans le réflexe des locuteurs : « Malgré les progrès de l’acceptation de la légitimité du créole dans la conscience des Haïtiens, beaucoup d’entre eux continuent à utiliser le français dans ce qu’ils considèrent comme les événements importants de leur vie, tels le mariage, le baptême, les anniversaires, les funérailles, etc. Spécialement le mariage et les funérailles…» (Tontongi, 2014: 170).
Il y a un fétichisme du non-emploi du créole haïtien dans les événements importants qui semble d’autant plus absurde qu’il n’est basé sur rien de valable pour le justifier. Vous souffrez, vous pleurez, vous vous réjouissez, vous faites des transactions commerciales, vous priez votre Dieu, vous communiquez avec votre famille et vos voisins dans la langue que vous parlez. Si c’est l’allemand, le mandarin ou l’italien, vous le faites dans cette langue. Si c’est le créole haïtien que vous parlez, la logique aurait dû être la même ; pourtant beaucoup d’Haïtiens croient encore que leur langue n’est pas tout à fait une langue comme les autres. J’ai relevé ailleurs comment une personne qui pleurait le trépas d’un bien-aimé a mal représenté cette simple expression de chagrin pour vouloir utiliser une langue, le français, qui n’était pas la sienne (Tontongi, 2007).
La persistance des préjugés anti-créole est manifeste dans les divers secteurs de la société haïtienne. Comment remédier à cet état de fait ? Comment faire pour établir et instituer la langue maternelle de la majorité des Haïtiens comme la langue principale dans un sens qui rétablisse et applique leur droit à la langue ?
2. La dimension insidieuse de la domination langagière
Dans la relation de pouvoir entre le français et le créole en Haïti, c’est sur le marché des interactions publiques–qui impliquent le rang, le rendement personnel et le prestige social–, que la compétition est plus intense et prononcée. De même qu’il est presqu’impossible qu’un marchand d’esclaves comprenne et ressente la condition de l’esclavage, de même il est impossible qu’un locuteur d’une langue dominante–avec tous les privilèges et état d’âme que ce statut offre–comprenne et ressente les sentiments d’un monocréolophone haïtien qui parle une langue dont on lui dit qui n’est pas normale et qui n’a pas droit au chapitre dans la société.
Il y a une dimension de la domination langagière qui est d’autant plus insidieuse et « invisible » qu’elle imprègne à la fois l’environnement social et l’émoi des locuteurs. Malgré les progrès qu’on a enregistrés dans l’émancipation du créole haïtien de son statut de langue mineure, voire de non-langue, les préjugés restent retranchés ; en dépit du semblant d’embrassade par l’intelligentsia francophile de la valorisation du créole comme langue première et principale de la nation haïtienne, beaucoup d’entre ses membres se transformant en champions de sa cause ; malgré la création de l’Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) et la publication, ça et là, des textes créoles dans des revues universitaires ou dans les pages du Nouvelliste ; oui, malgré cette orientation encourageante vers une nouvelle épistémè linguistique en Haïti, le chemin reste encore long et pavé d’embûches et d’incertitudes.
S’agissant des réflexes institutionnels et tempéramentaux qui obstruent le processus de valorisation du créole haïtien, je peux prendre en exemple l’incident suivant : En 2016, l’Université d’État d’Haïti a annoncé la tenue en Haïti, au cours du mois de novembre, d’un colloque sur la recherche scientifique intitulé « Recherche universitaire en Haïti et Coopération : entre contraintes et opportunités ». Un seul problème, toutefois : l’appel à communications indique carrément qu’elles doivent être en français ou en anglais. Pas en haïtien. Pourquoi pas ? Beaucoup d’entre nous autres qui supportons l’UEH et admirons le militantisme pro-créole de son corps dirigeant, étaient scandalisés par cette décision. Faisant suite au professeur de York College, Kiran Jayaram, qui demande simplement pourquoi c’était « obligatoire » pour les résumés d’être en français ou en anglais et pas en créole haïtien, j’ai envoyé aux organisateurs un courriel leur disant que c’était une grande erreur de faire sortir cette annonce qui rejette le créole, la langue parlée par tous les Haïtiens, dans un colloque scientifique en Haïti alors que nous affirmons qu’il est la langue légitime des Haïtiens. Je leur ai recommandé de rectifier l’erreur. Les linguistes et activistes créolistes Michel DeGraff, Frenand Léger, Pierre Chéry, Sauveur Joseph, Jimmy Fedna et Donald Dauphin ont également envoyé des courriels questionnant la décision et demandant rectification. Michel DeGraff a estimé que le colloque offre une opportunité à l’UEH de donner l’exemple que le créole puisse être utilisé dans la recherche scientifique avancée. L’un des administrateurs de UEH, James Saint-Cyr, m’a envoyé tout de suite après une note-réponse indiquant qu’il travaille à la rectification du problème1.
J’étais donc très heureux de recevoir, deux semaines plus tard, une nouvelle annonce promotionnelle de la part des organisateurs du colloque qui inclut le créole comme l’une des trois langues dans lesquelles les propositions de communications devaient être soumises.
Cette dimension insidieuse de la domination langagière recouvre aussi les plus mondains éléments de la vie de chaque jour. À l’hôtel Le Plaza au Champs-de-Mars, à Port-au-Prince, où ma famille et moi étions hébergés en juillet 2016, j’ai remarqué que les réceptionnistes, les serveurs, les serveuses et le personnel administratif s’adressaient à nous en général en français à chaque fois que nous devions nous entretenir avec eux. Je leur répondais toujours en haïtien, me faisant un point d’honneur de ne jamais répondre en français ; ils n’insistaient pas cependant et continuaient la conversation, avec grand plaisir, en créole haïtien. Mes interlocuteurs étaient toujours trop heureux de retourner dans l’aisance familière de leur langue maternelle pour en faire un problème. Dans ma chambre d’hôtel, il y avait un coffre-fort de sécurité (“safe deposit box”) qui donne des instructions sur comment l’opérer en dix langues (français, anglais, espagnol, allemand, italien, japonais, chinois, russe, coréen et arabique), mais non en créole haïtien. De plus, parmi la douzaine d’émissions télévisuelles que je pouvais capter sur l’appareil de télévision de ma chambre, seule une était en haïtien. Le français et l’anglais dominaient la majorité des autres.
Comme tout autre aspect de la société haïtienne, la problématique linguistique, ou plus exactement la politique de langue, est imbriquée dans des paradoxes et contradictions qui ne sont pas toujours explicables à première vue. Par exemple, Haïti est le pays qui a créé une langue qui couvre toute la superficie de son territoire et mais aussi le pays où sa nouvelle classe dirigeante impose la langue française comme langue et culture dominantes, et qui ne se gêne pas de mettre sur pied des paravents de contrôle et des mécanismes répressifs pour maintenir le créole haïtien dans son ghetto linguistique. Il est à la fois le pays qui proclame l’irréductibilité de l’Être à la condition strictement animale et le pays incubateur d’une poignée des plus sanguinaires dictatures de l’Histoire, telles celles de Nord Alexis au commencement du xxè siècle et de Papa Dòk et Bebe Dòk vers le milieu et la fin du xxè siècle.
Même si les Tonton-Macoutes étaient pour la plupart semi-illettrés et ne parlaient que le créole, comme en cela le reste du peuple haïtien, François Duvalier et, plus tard, son fils Jean-Claude, prononçaient presque l’ensemble de leurs discours officiels en français. Ni le père ni le fils n’y avaient vu de problème, et pas non plus leurs plus véhéments critiques et opposants qui provenaient du même moule francophile et auto-dévaluant façonné par le milieu ambiant. Ce « milieu » ambiant n’est pas trop difficile à comprendre quand on connaît le monopole que l’État haïtien a concédé en 1860 aux Frères de l’Instruction Chrétienne, une officine de l’Église catholique, en signant un Concordat qui leur donnait le droit exclusif d’enseigner aux Haïtiens. Ainsi, l’État français du Second empire de Louis-Napoléon Bonaparte était-il donné, par l’entremise de l’Église catholique, le monopole pour instruire des nègres qui avaient eu l’audace de se déclarer indépendants de la France, la « mère-patrie », seulement quelques années plus tôt !
3. La politique de langue comme choix politique
L’évolution des mœurs et la mutation politique qui avaient rendu possible, aux xviè et xviiè siècles, l’émergence du français, de langue infériorisée et dominée, au statut de langue respectée et dominante, ont été remarquables à bien des égards. Sont-elles possibles en Haïti ? Oui et non. D’abord non, parce que, contrairement à la France du xviiè siècle, Haïti n’est pas aujourd’hui en mesure–au moins dans le court et moyen termes–d’imposer sa langue comme langue dominante. Oui, parce que l’élan de défiance et de fierté linguistique qui parcourait le peuple français dans la revendication de sa langue vernaculaire comme l’expression fondamentale de son identité de peuple par rapport à l’élitisme impérialiste du latin, une langue dont l’emprise dominante s’affirmait au détriment du français, ce même élan peut stimuler le peuple haïtien vers la conquête totale de son indépendance linguistique et culturelle par rapport au français, la langue de l’élite intellectuelle qui recouvre aussi l’élite politique et socio-économique.
La politique de langue–c’est-à-dire l’emploi de la langue comme moyen pour exclure et dominer–, est un choix politique, comme elle l’a été après le 1er janvier 1804, tout comme elle l’est aujourd’hui après la création de l’Akademi Kreyòl Ayisyen. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est un consensus national sérieux sur le choix de l’équi-bilinguisme, c’est-à-dire la parité réelle, proportionnelle, entre les deux langues au profit du créole, particulièrement dans les institutions scolaires, les médias et l’administration de l’État. L’habitude crée la normalité. Pourquoi beaucoup plus de membres de la société civile n’insistent-ils pas pour que la langue créole et son pendant écriturel servent de mode de communication principal à tous les niveaux dans la société haïtienne ?
Mon inquiétude en ma qualité de militant pour la valorisation de la langue créole haïtienne, c’est qu’on continue à négliger la valeur du créole haïtien comme langue génératrice de valeurs, comme elle l’est véritablement, particulièrement dans la productivité du potentiel économique et biopolitique qu’elle recèle pour onze millions de locuteurs locaux.
En Haïti, on utilise le français, non pas comme moyen de communication, mais plutôt comme titre de noblesse pour épater et signaler un rang social jugé enviable. Les classes victorieuses dominantes (les grands dons, les généraux noirs, les possédants mulâtres, les grands commerçants, etc.), ayant choisi le français et la culture française comme modèle d’excellence éducatif, intellectuel et spirituel (Toussaint, Dessalines, Pétion, Rigaud étaient de véhéments défenseurs et dévots du catholicisme), avaient en même temps choisi de ravaler leur langue (le créole) et la culture vodou à un rôle subalterne, inférieur, voire illégitime. Le Concordat de 1860 entre l’État haïtien et l’Église catholique viendra cimenter cette tendance et aura pour résultat pratique la marginalisation, au niveau du référent identitaire, de la langue et de la culture populaires, même si celles-ci sont pratiquées par l’écrasante majorité de la population.
4. Une troisième option
Dans le rapport, souvent de nature impérialiste, entretenu entre les langues, y compris entre les langues dominantes elles-mêmes, des alliances et récriminations peuvent survenir là où l’on s’attend le moins. On voit cette dynamique en jeu dans le rapport triangulaire entre le français, le créole et l’anglais, plus particulièrement au sein de la diaspora haïtienne aux États-Unis. En effet, étant donné la résonnance des revendications créolistes parmi les centres importants de la diaspora haïtienne aux États-Unis (New-York, Miami, Boston) et au Canada (Montréal en particulier), la légitimité du monopole du français comme langue de représentation dominante s’en trouvait ébranlée et mise sur la défensive. Pour résoudre ce problème–et pour éviter de se défendre de la critique d’employer le français au détriment du créole ou simplement par manque d’habitude et de maîtrise du français–, les ressortissants haïtiens assimilés (grâce à l’éducation ou à la longue durée de leur séjour au pays d’accueil) recourent à une troisième option : l’usage de l’anglais. Ainsi, comme je l’ai vu moi-même en maintes occasions, dans une assistance composée à 99% d’Haïtiens, beaucoup d’entre eux monocréolophones, la cérémonie (du mariage, du baptême ou de l’enterrement) est officiée en anglais, une nouvelle tendance qui rejette toutes les deux langues officielles d’Haïti sans résoudre le problème inhérent à l’interlocution dans une langue étrangère, incomprise par la majorité de l’assistance. L’implication de cette tendance peut mener à une situation où à la fois le créole haïtien et le français sont recalés dans l’insignifiance, voire la disparition, au profit de l’anglais, le « nouveau sheriff du quartier », pour employer une expression familière du terroir pour rendre compte d’un changement d’autorité…
C’est contre cette menace au statut du français comme langue dominante et à celui du créole haïtien comme relève (ou comme symbole de victimisation), que se révolte le linguistes R. Berrouët-Oriol. Dans un article polémique publié sur son site berrouet-oriol.com, « Remarques sur le français haïtien, une variété à part entière », R. Berrouët-Oriol se lamente du fait qu’on a utilisé uniquement l’anglais dans la 41è conférence annuelle de l’Association des études de la Caraïbe, tenue du 6 au 11 juin 2016 à Port-au-Prince, Haïti. Il cite un article du Nouvelliste qui a rapporté qu’une participante à la conférence, Myrlande Pierre, a critiqué « le fait que les deux langues officielles d’Haïti, le créole et le français, ont été négligées dans les diverses présentations des ateliers. (…) » Il est donc impératif, à ses yeux, que les langues d’usage du pays soient davantage prises en compte en mettant à contribution, par exemple, tous les moyens technologiques, de traduction simultanée » (Berrouët-Oriol, 2016). Il a également critiqué l’annonce d’un symposium tenu les 27 et 28 mars 2017 à Port-au-Prince par le MIT-Haïti Initiative qui « est consignée en anglais et en créole uniquement, à l’exclusion du français, l’une des deux langues officielles du pays car cette langue est la plupart du temps considérée par certains linguistes formés aux États-Unis comme une langue “totalement étrangère” en Haïti. (…) Cette mal-vision sectaire et dogmatique est un contre-sens historique et elle induit la fausse idée selon laquelle il y aurait en Haïti une “guerre des langues” plutôt qu’un usage dominant d’une langue (le français) par rapport à une autre (le créole) dans la dynamique de rapports sociaux et économiques fortement inégalitaires en Haïti de 1804 à nos jours ». R. Berrouët-Oriol a coédité avec le linguiste H. St-Fort le livre La question linguistique haïtienne / Textes choisis (2017) où ils touchent un très long éventail de la problématique linguistique en Haïti, particulièrement en relation à la langue créole ; mais à lire le sommaire on observe que sur 28 chapitres et textes, seulement trois (écrits par St-Fort) sont en créole haïtien. Or, ils sont l’un et l’autre parmi les plus véhéments critiques du décalage linguistique en Haïti, y compris R. Berrouët-Oriol qui présente des propositions fort judicieuses pour y remédier.
Fort souvent, cependant, le sort du créole haïtien dans sa relation d’infériorité par rapport au français–et de ces derniers avec l’anglais hégémonique–, n’est pas la plus urgente des inquiétudes. Pour beaucoup de critiques, en dépit de leur semblant de promotion et valorisation du créole comme langue légitime, la perte d’influence du français par rapport à l’anglais est une évolution d’autant plus redoutable qu’elle menace tout un attirail de privilèges dérivés du statut dominant du français. En fin de compte, c’est une querelle de famille, au sein d’une confrérie de locuteurs privilégiés.
À la vérité, les Haïtiens monocréolophones, pour la plupart mis dans la marginalisation par la culture francophile dominante, ne s’inquiètent pas outre mesure de la perte d’influence du français au niveau local, ni international. Pourquoi s’en inquiéteraient-ils ? Au juste, ce que certains critiques reprochent aux organisations non-gouvernementales qui adoptent le créole au détriment du français, ce n’est pas tant leur exclusion du français que leur adoption du créole haïtien comme langue représentative des Haïtiens dans leur service de traduction. Cette parité traductionnelle était un domaine réservé au français, anglais-français, pas anglais-haïtien.
C’est un relativisme que les États étatsuniens tels New York et Massachusetts ne s’encombrent pas, eux qui reconnaissent le créole haïtien comme la langue principale des ressortissants haïtiens, au moins dans la pratique, particulièrement dans les services de traduction qu’ils offrent (par exemple les documents officiels, les soins médicaux, les procédures des tribunaux, etc.). Il y a un point dans les arguments de R. Berrouët-Oriol cités plus haut qui suggère qu’on doit espérer une parité totale entre les langues française, anglaise et haïtienne. C’est une très judicieuse espérance, mais en réalité, pour que le créole rattrape le temps et les avantages perdus par rapport au français, il faudra qu’on institue en Haïti une politique linguistique comparable à la politique dite affirmative action aux États-Unis : une série de mesures administratives qui légifèrent certains avantages préférentiels aux Noirs à cause du déficit de leur statut en tant qu’exclus et dominés dans le ci-devant (et malheureusement toujours actuel) système de discrimination raciale aux États-Unis.
C’est à cause de ces souhaits que nous préférons le terme équi-bilinguisme ou un bilinguisme paritaire proportionnel qui prenne en considération le fait qu’une estimation entre 95% et 99.9% de personnes parlent le créole en Haïti, comparé à plus ou moins 10% qui parlent aussi le français. Une vraie parité doit être basée, d’une part, sur la proportionnalité linguistique de la population haïtienne et, d’autre part, sur la considération des abus désavantageux subis par les monocréolophones au cours de plusieurs siècles ; d’où la nécessité pour l’affirmative action…
Éventuellement, en plus des efforts individuels et des initiatives institutionnelles comme l’Akademi Kreyòl Ayisyen, il faudra aussi toute une révolution en profondeur des mœurs et de la culture francophile en Haïti, pour que la langue créole et la culture vodou puissent être véritablement reconnues comme les référents légitimes qu’elles sont pour l’authenticité identitaire des masses et de la nation haïtiennes. Il faudra surtout des actions fortes et volontaristes de l’État, entre autres, par voie d’une loi d’aménagement linguistique–nécessairement bilingue, telle que le propose R. Berrouët-Oriol–pour imposer aux milieux réfractaires et récalcitrants une politique linguistique qui valorise le créole en tant que langue première et principale, comme part de la politique de libération et de développement de la nation–dans la perspective, bien entendu, de la reconnaissance que la langue française et une bonne part de la culture française2, bien qu’héritées du colonialisme français, demeurent un patrimoine haïtien à part entière à cause de leur enracinement dans l’histoire et dans la littérature de la nation haïtienne. Pour cela, bien sûr, nous devons commencer par voir le créole et la culture vodou comme des atouts indispensables à ce projet de reconquête de soi.
5. La langue comme capital humain et génératrice de valeurs
Je résumerais mon appréciation du récent livre de R.S. Édouard, Éducation, capital humain et développement social par le créole en Haïti, en disant qu’il tient haut la fonction de l’éducation, et la langue dans laquelle elle est dispensée, comme facteur générateur de valeurs et de complétude d’être.
Après en effet un long tour d’horizon historique sur l’état de l’éducation et de l’enseignement en Haïti, partant de la révolution de 1843 qui a installé Charles Rivière-Hérard au pouvoir, lequel fonde le Ministère de l’Instruction Publique, avec Honoré Féry à sa tête, R.E. Édouard dresse un premier constat :
Féry a jeté les bases solides pour un développement équitable, efficace et durable de l’éducation. Il ouvre les lycées du Cap Haïtien et des Cayes, portant à trois le nombre de lycées nationaux. Ainsi en février 1845, Haïti comptait 22 établissements scolaires publics (trois lycées nationaux, 16 écoles primaires nationales et trois écoles primaires communales) pour le développement de la jeunesse. (…) Mais il faut attendre l’arrivée du président Fabre Geffrard pour que l’éducation soit, de façon conséquente, revalorisée et développée.
On sait comment cette éducation a été « revalorisée et développée » suite à une succession d’échecs des politiques éducatives. Arrivé au pouvoir en 1859, Fabre Geffrard a fait de la réorganisation des écoles publiques sa priorité. Pour atteindre ce but, il signe un Concordat avec le Saint-Siège dont l’une des clauses stipule que le catholicisme est la religion officielle de l’État haïtien. Mais le plus grand tort qu’aura causé le Concordat de 1860, c’est d’abord de reconnaître la langue française comme la seule langue officielle–et d’éducation–en Haïti, et ensuite de donner aux enseignants français de l’Église catholique le monopole de dispenser l’éducation en Haïti, y compris la publication des textes scolaires en usage.3
L’indemnité de 1825 imposée par la France a handicapé le développement de la nouvelle nation. Plus tard, avec l’arrivée des premières congrégations religieuses dont celle des Frères de l’Instruction Chrétienne en 1864, l’ancienne métropole a réussi à maintenir une certaine influence grâce à la langue et la culture. On peut imaginer la satisfaction des stratèges du gouvernement français en vue de ce grand coup de diplomatie qui donne à la nation vaincue d’une guerre de libération le monopole pour éduquer la nation vainqueresse ! C’est cette inversion qui a eu lieu en Haïti et qui continue encore aujourd’hui dans une large mesure.
R.S. Édouard semble penser qu’il y a une possibilité de remédier à la problématique linguistique haïtienne par un « bilinguisme équilibré », tel que le voyait la réforme Bernard de 1979–1982 : « L’introduction : d’une école fondamentale de trois cycles en dix ans ; du créole comme langue d’enseignement et comme objet d’apprentissage ; du français oral en première et en deuxième années et du français écrit à partir de la 3e année… » (Édouard, 2017). En réalité, comme Édouard le sait lui-même, la problématique est plus compliquée que cela.
Il y a certainement, ces derniers temps, un élément volitif, un effort de volonté délibéré dans la quête d’un équilibre linguistique en Haïti entre français et créole. Mais, on a vu aussi comment, depuis la réforme Bernard des années 1980, les intellectuels et les responsables politiques se complaisent dans un bilinguisme de façade, faussement « officiel » dans la mesure où une majeure partie des activités de l’État et de son administration se fait en français. Le mouvement dit indigéniste dans la littérature et dans les arts dans les années 1920 et 1930 avait voulu rompre avec les préjugés racistes prônés par Arthur de Gobineau et ses disciples, à savoir la supériorité de la race blanche–des préjugés directement hérités du colonialisme qui cherchait un fondement théorique, pseudo-scientifique, à son exploitation, objectification et abjectification des êtres humains, jugés « autres ». Mais l’autre préjugé, linguistique celui-ci, qui a placé le créole dans le ghetto social, n’a jamais été adressé avec la même vigueur.
Quant à la notion d’équilibre des deux langues, M. DeGraff l’a ironisé dans sa présentation au colloque sur l’Académie du créole haïtien tenu en Haïti en octobre 2011 : « Objektif “bilengwis ekilibre” sa a (pou tout Ayisyen ta vin maton nan kreyòl ak franse) se yon objektif ki enterese m anpil kòm lengwis. Ki “operasyon” gouvènman an pral devlope pou li fè tout Ayisyen vin pale franse nan menm nivo yo deja pale kreyòl ? Ki sa gouvènman an deja fè pou li vreman mete kreyòl ak franse nan menm nivo alòske majorite sa ki pibliye nan MENFP ak nan lòt biwo Leta se an franse sèlman yo pibliye ? Piblikasyon sa yo pa “ekilibre” ditou. Ki fè, Leta pa pratike sa l ap preche ni nan Refòm Bernard, ni nan Konstitisyon an, ni nan Plan operasyonèl la. »
Bien que R.S. Édouard ait finalement énoncé, dans le dernier chapitre du livre, l’importance indispensable du créole haïtien en tant qu’à la fois langue d’enseignement et objet d’enseignement, il n’a pas montré clairement comment le créole lui-même, à part d’être une langue utilisée par onze millions de locuteurs, est un capital humain indispensable—ni comment prendre avantage de ce capital…
Ce lapsus est probablement lié à la formation éducative française de R.S. Édouard qui l’amère à croire qu’un « bilinguisme équilibré » est possible et résoudrait les problèmes comme par enchantement, ne tenant pas suffisamment compte de ce que nous vivons dans le bilinguisme « officiel », sou papye, depuis trente-cinq ans, soit depuis les réformes de 1979–1982. Le bilinguisme équilibré est un rêve impossible parce qu’il prend pour prémisse que les bonnes volontés prévaudraient dans le meilleur des mondes.
Pourtant, malgré la lenteur du renversement correctif nécessaire, des cardinaux de l’intelligentsia haïtienne, de formation éducative française ou franco-canadienne pour la plupart, viennent à prendre la cause de la valorisation du créole comme langue légitime, totale-capitale, qui peut être une partenaire à droits égaux dans un bilinguisme paritaire, équilibré. Des chercheurs et écrivains tels Hugues St-Fort, Robert Berrouët-Oriol, Leslie Péan, Maximilien Laroche, Lyonel Trouillot, etc. viennent en tête. Ceux-ci ne forment certainement pas une orthodoxie, ni même un groupe organisé, et ils ne sont même pas conscients de leur « similarité », mais ils ont en commun l’accession à la notoriété grâce à leur formation/production dans la langue française, certains d’entre eux professeurs dans les universités occidentales prestigieuses. Cela sous-entend qu’ils sont bénéficiaires d’un certain privilège linguistique qui les rendrait, à leur insu, défenseurs du patrimoine français en Haïti.
Ces auteurs semblent se positionner comme les défenseurs de la partie « française » de la binarité linguistique haïtienne, un rôle dont ils se sentent d’autant plus confortables à remplir qu’ils sont en même temps des défenseurs de la valorisation du créole qu’ils estiment injustement déprécié dans la société de classes haïtienne. D’où leur appréciation des concepts tels « bilinguisme paritaire », « bilinguisme équilibré », « parité statuaire », etc. Parmi eux, R. Berrouët-Oriol est le plus actif ces derniers temps ; il a écrit avec une série d’articles qui forcent tous ce point, l’un des derniers en date, « Faut-il exclure le français de l’aménagement linguistique en Haïti ? », est particulièrement virulent : « La volonté implicite ou explicite d’exclusion de la langue française de tout projet d’aménagement linguistique en Haïti procède donc non pas des sciences du langage mais bien d’une mal-vision réductionniste de nature idéologique des faits de langue au pays. De manière générale elle fonctionne sur le mode de la croisade catéchétique d’une “défense” unilatérale et borgne de la langue créole que les “intégristes francophages”, très minoritaires en Haïti et outre-mer, s’efforcent d’opposer à la langue française. » Cet auteur semble s’engager dans une sorte de contre-croisade pour ce qu’il appelle le « patrimoine linguistique bilingue » haïtien, se disant « [plaider] pour que, dans la Francocréolophonie haïtienne, le futur aménagement simultané des deux langues officielles du pays soit mis en œuvre sur le terrain des droits citoyens et des obligations de l’État dans le domaine linguistique ». Il prend Lyonel Trouillot à témoin, citant un article qu’il a écrit quelques douze ans auparavant :
La seule politique linguistique pouvant corriger le déficit de citoyenneté perpétué par la situation linguistique d’Haïti me semble être la construction à moyen terme d’un bilinguisme créole-français pour l’ensemble de la nation. La tentation facile de considérer le français comme une langue étrangère comme une autre, l’anglais par exemple, me semble un refus délibéré de tenir compte d’une donnée fondamentale : la nécessité de préserver la spécificité culturelle de notre État nation dont l’une des composantes est le patrimoine linguistique. (Trouillot : « Ki politk lengwistik pou Ayiti ?», Le Nouvelliste du 7 juillet 2005, repris par Berrouët-Oriol, 2017b).
On aurait aimé voir comment les auteurs que R. Berrouët-Oriol critiquent avec une telle virulence répondraient à ses attaques et aussi à son concept de « francocréolophonie », qui nous paraît plutôt hybride à première vue…
En face de ceux-ci, il y a l’autre camp formé de linguistes et créolistes tels Yves Dejean, Michel DeGraff, Macky Jean-Pierre, Manno Eugène, Michel-Ange Hyppolite, Jean-Robert Placide, etc., qui ne font pas grand cas de la langue française en Haïti et qui, même s’ils ne le préconisent pas ouvertement, ne verraient pas d’un mauvais œil le démantèlement total de l’influence du français en Haïti. À vrai dire, ceux-là ne sont pas contre le bilinguisme comme tel, mais plutôt contre un certain emploi du bilinguisme pour perpétuer (et qui perpétue en fait) la domination française en Haïti.
6. Une pensée pro-créole dans la coriacité des structures d’exclusion dominantes
Entre les deux pôles de la polémique sur le fait de savoir si oui ou non le français est une langue étrangère, donc traitée comme telle, c’est-à-dire comme langue seconde et non principale, il y a une position intermédiaire, à mi-chemin entre les deux, occupée par le linguiste R. Govain. Dans un essai qu’il a écrit en réponse au texte de L. Trouillot cité plus haut par R. Berrouët-Oriol, il emmène les arguments pro-créoles avancés par Trouillot vers des défis plus concrets. Tout d’abord, il réfute le manichéisme langue-étrangère contre langue-maternelle ou nationale : « Le français en Haïti, dit-il, n’est ni une langue maternelle ni une langue totalement étrangère. Je dirais cependant qu’il est plus proche du qualificatif “étrangère” que de celui de “maternelle”. Le degré de xénité dans ce cas peut venir de la distance qui sépare le locuteur de la pratique effective de la langue. »
R. Govain semble avoir été particulièrement irrité quand Trouillot a demandé qu’on valorise la langue créole « par des mesures claires et contraignante », c’est pourquoi, dans son texte-réponse, il a averti contre le trop-plein de dirigisme dans l’aménagement de la langue : « L’erreur de beaucoup de linguistes et de beaucoup de grammairiens consiste à croire qu’ils sont aptes à édicter des règles de pratiques langagières, c’est‐à-dire des normes prescriptives. On ne peut non plus modifier facilement les formes de pratique des langues à coup de décret ou par l’adoption de mesures contraignantes, drastiques ou coercitives. » C’est en effet une très judicieuse mise en garde contre la prédisposition des élites intellectuelles à handicaper le flot naturel de la langue au profit d’un agenda culturel élitaire ou formaliste, tout comme Michel Foucault l’a signalé s’agissant de la Grammaire générale, éditée au xviiiè siècle au service d’une certaine mission culturelle du savoir et de son pouvoir.
R. Govain s’en prend également à la notion que le créole ne serait pas une langue dans laquelle on peut véhiculer des concepts scientifiques :
Les concepts ne seront disponibles dans la langue, dit-il, qu’à partir du moment où ils y auront été employés au moins une fois pour exprimer une réalité de l’expérience linguistique. Si aucun locuteur n’a senti la nécessité ou l’obligation d’exprimer cette réalité pour laquelle il aurait à élaborer des concepts, ces derniers ne seront pas disponibles dans la langue : l’existence du mot ou du concept répond à un besoin de communication (communiquer une pensée, un savoir, une expérience…). Ce n’est pas que les catégories conceptuelles soient absentes en créole. C’est que la pratique linguistique des locuteurs, notamment de l’élite intellectuelle, ne leur impose pas de nécessité de les mettre en évidence ou de les “activer”, puisque pratiquant déjà une langue minorante par rapport au créole qui est minoré, une langue où ces concepts scientifiques sont immédiatement présents.
Pour renforcer ce point et bien mettre en évidence l’importance ou le rôle de la production dans la performance linguistique, R. Govain conclut :
Il semble que l’épanouissement et le développement d’une langue dépendent de sa vitalité. Et sa vitalité dépend, elle, des facteurs démographiques et sociaux. Les langues ne disposent certes pas des mêmes puissances et ne réagissent pas de la même façon quand elles sont en contact. De ce fait, on peut dire que la domination d’une langue par une autre n’est pas quelque chose qui se réalise naturellement, mais en fonction de facteurs sociaux et politiques ou même économiques.
Il faut remarquer que ces lignes sont écrites en 2005, soit un quart de siècle après la réforme Bernard et dix-huit ans après l’officialisation du créole par la Constitution de 1987, plaçant ainsi Govain, depuis au moins cette date, parmi ceux qui ne sont pas dupes du statut « officiel » et le prend pour ce qu’il est en réalité :
le statut officiel du créole est plutôt symbolique et n’est pas proportionnel avec son potentiel fonctionnel. Le potentiel fonctionnel du créole est certes élevé mais n’entraîne pas une valorisation de son statut. En termes démographiques, le créole est parlé par presque toute la population haïtienne. Il se trouve que le facteur démographique, quoiqu’indispensable, est atténué par ces facteurs évoqués plus haut. On peut donc en conclure que le nombre de parlants en lui-même ne suffit pas à assurer le statut d’une langue. Sinon, le créole n’attendrait pas jusqu’à 183 ans après l’Indépendance pour se voir attribuer le statut de langue officielle.
À vrai dire, les positions respectives de L. Trouillot et de R. Govain dans ces deux textes ne sont pas trop différentes l’une de l’autre dans l’essence de ce qu’ils disent, mais, déjà, R. Govain voyait l’impasse où pourrait mener un bilinguisme laissé à lui-même. À la fin, on est frappé par les positions irrévocablement pro-créoles de ces deux auteurs, même si elles sont formulées un quart de siècle après la réforme Bernard. La problématique de crise et la nécessité d’une approche corrective qu’ils lamentaient et exhortaient en 2005 est aujourd’hui encore (2017) opérante et pertinente dans la réalité de chaque jour. En effet, les problèmes linguistiques–et les manquements socio-structurels qu’ils indiquent–sont vécus par les monolingues haïtiens comme une réalité incontournable, voire comme un sort.
Les analyses de R. Govain, et dans une moindre mesure de Trouillot, sur la situation linguistique haïtienne en 2005 semblent plutôt confirmer la conclusion de M. Saint-Germain en 1997 sur la réforme Bernard, entre autres que « la valorisation du créole n’est pas évidente malgré les acquis que la langue a enregistrés dans le domaine de la vie politique ». Rien ne laisse penser que la situation ait vraiment changé en 2017, même si, sur un plan strictement phénoménal, il y a eu en Haïti une évolution dans certaines pratiques socio-culturelles qui dénote un tant soit peu de progrès, telles la production de plus en plus de livres de tous genres rédigés entièrement en créole haïtien et la représentation de ceux-ci dans les foires de livres locales et dans la diaspora haïtienne ; la fondation (et la popularité) de l’Akademi Kreyòl Ayisyen, etc. Naturellement, ces changements positifs n’ont guère éclipsé–loin de là–l’exercice dominant du français en Haïti et n’ont pas fait bouger fondamentalement les structures sociale, économique, culturelle et intellectuelle coriaces qui le soutiennent.
Le vœu de R. Govain (2005) que « l’État entreprenne la mise en place d’une politique linguistique et d’un processus de planification linguistique dans la perspective de régulation de la pratique linguistique haïtienne » est resté jusqu’ici un vœu pieux parce que l’État ne se sent pas suffisamment pressuré par la société civile et les forces intellectuelles et productives du pays pour en faire une priorité. En outre, les habitudes ou comportements écriturels proprement dits doivent aussi changer : les écrivains aideront beaucoup la-dessus s’ils s’habituent à écrire dans les deux langues et surtout en créole haïtien, la seule façon de le faire respecter comme une langue totale-capitale.
Ainsi, malgré l’avancement de l’haïtien dans les médias et sa continuelle acceptation dans la société en général, il restera potentiellement inachevé si l’intelligentsia n’écrit pas dans cette langue ; c’est la condition fondamentale et indispensable de la reconnaissance de sa complétude linguistique comme langue première. La représentation du créole haïtien dans les interfaces d’ordinateur, sa codification softarisée à MIT, son enseignement à l’école, etc., sont certainement des étapes importantes, mais la plus déterminante des étapes est l’acte d’écrire en haïtien par les écrivains, leur défense de la langue, et surtout leur respect, leur engagement pour sa valorisation généralisée dans la société.
Cet échange entre L. Trouillot et R. Govain en 2005 sur la meilleure stratégie à adopter face à la problématique linguistique haïtienne montre à la fois un haut degré de réflexion sur le sujet et, bien malheureusement aussi, l’évidence que, douze ans plus tard, la mystification entourant les rapports linguistiques en Haïti reste aussi étanche qu’elle était deux cents treize ans plus tôt.
7. La langue comme facteur d’identité et de complétude
Wilhelm von Humboldt a postulé avec grande autorité, l’histoire des conquêtes et des impositions linguistico-culturelles lui servant comme support, que toute langue renferme, possède et véhicule une vision du monde et une culture. Si c’est une langue dominante, ce sera une culture dominante. Ce postulat est secondé par A. Schaff qui, dans Langage et culture, approfondit la thèse humboltienne en lui apportant un renfort théorique additionnel : « Le langage, qui est un reflet spécifique de la réalité, est également, dans un certain sens, le créateur de notre image du monde. Dans ce sens que notre articulation du monde est fonction, du moins dans une certaine mesure, de l’expérience non seulement individuelle, mais aussi sociale, transmise à l’individu par l’éducation et avant tout par le langage. » (Schaff, 1964: 236) L’histoire d’Haïti et celle de sa langue majoritaire sont inscrites dans une dynamique géopolitique et interculturelle où elles étaient partant défavorisées. Entre les loa du panthéon vodou, dépaysés de leur Afrique ancestrale, et les textes magistraux de Voltaire ou de Montesquieu, il n’y avait pas de commune idéation, ni de commune projection existentielle. Après la révolution de 1791–1804, il fallait choisir son camp de référence culturelle. Sans le savoir, les leaders des va-nu-pieds qui luttaient si vaillamment pour leur libération, allaient, de leur autre côté, donner volontairement leur âme (et leurs sens d’eux-mêmes) à ces maîtres mêmes qu’ils venaient de vaincre et chasser du pays. C’était une sorte de coup d’État par l’effet de l’étourdissement culturel. Un coup d’État en douceur, parce que personne n’en objectait ; et personne n’en objectait parce que personne ne l’a vu comme tel. Un coup d’État d’autant plus invisible qu’il était submergé dans les ténèbres du non-dit ou dans l’imposition de l’évident, du qui-va-de-soi. La culture dominante (celle des anciens maîtres et des nouveaux dirigeants) avait en effet ce pouvoir de faire paraître comme le Réel–l’incontournable Réel–, cela même qui relève de ses désirs. Pourtant, quoi qu’on puisse dire du génie de la domination linguistico-culturelle, elle cause aussi des victimes réelles. Celles-là pour qui la non-existence dont leur langue maternelle a été punie constitue encore une source de brimades et d’ostracisme.
Dans le cas du monocréolophone haïtien, qui est dans la majorité des cas ce que Manno Charlemagne appelle un « défavorisé » (soit un prolétaire, un lumpenprolétaire, un paysan sans terre ou un chômeur), la langue et la culture sont vécues comme un domaine réservé à un certain groupe, une certaine classe, sinon une certaine race (et leurs alliés).
Des sceptiques se demanderaient peut-être pourquoi cela est-il un problème ? C’est un problème parce qu’un autre monolingue, dans une différente circonstance nationale (tels un Hollandais, un Russe, un Norvégien, un Égyptien ou un Italien), ne se poserait pas une telle question. Remarquons que je mentionne ici une pluralité de nationalités et de langues qu’on peut appeler, dans une certaine mesure, dominantes ou impérialistes, quand vues dans des contextes de cohabitation avec d’autres langues jugées « inférieures ». En effet, toute langue, quelle qu’elle soit, participe dans une relation de pouvoir, que celle-ci soit ethno-géographique, politique, culturelle ou autre. Une relation de pouvoir qui est aussi, bien entendu, linguistique, particulièrement quand une langue est pratiquée dans une sphère publique d’interlocution diglossique où elle est confrontée à une autre langue qui est plus puissante en termes de pouvoirs politique, symbolique et élitaire, comme c’est le cas en Haïti.
Dans le cas particulier d’Haïti, la problématique linguistique est indissociable des relations de pouvoir existant parmi les classes sociales et les regroupements socio-culturels de toutes sortes. En fait, il y a deux sortes d’environnements hostiles que le monolingue haïtien doit confronter. D’un côté, ce que Roland Barthes analyse dans ses concepts de langage « encratique » et langage « acratique », le premier se référant au langage du pouvoir et ses appareils institutionnels et idéologiques, le deuxième aux discours spécialisés tels la psychanalyse ou le marxisme ; de l’autre côté, le rapport de domination entre le français et le créole dans un environnement où ce dernier est déprécié. Naturellement, cette problématique particulière–le rapport de domination français/créole–, s’ajoute à la problématique normale où vivent les relations linguistiques dans la plupart des pays du monde, « il y a une division des langages, dit Barthes, qu’aucune science simple de la communication ne peut prendre en charge : la société avec ses structures socio-économiques et névrotiques, intervient, qui construit le langage comme un espace de guerre » (Barthes, 1984: 135).
Le paradoxe haïtien, c’est que, de tous les défis du pays, la problématique linguistique est le plus facile à surmonter, simplement parce que le pays a une langue qui est parlée dans la totalité de sa superficie géographique et par l’entière composante de sa population. Un avantage d’une grande portée stratégique étant donné les multiples valeurs ajoutées que celui-ci procure. Le problème a plus à voir à l’autodénigrement que favorise le bovarysme culturel haïtien dénoncé par Price-Mars qu’à son pendant linguistique. C’est comme si le pays est en continuel conflit avec lui-même, comme il l’est, tout au long de son histoire, dans la sphère politique.
2. Le bilan de la réforme Bernard
Étant donné les malversations de toutes sortes qu’a commises le régime de Jean-Claude Duvalier, on a du mal à imaginer qu’il y aurait quelque chose de positif qui en sortait ; cependant, la réforme éducativo-linguistique connue sous le nom de « réforme Bernard » a été tant soit peu un progrès, comparée à plus d’un siècle et demie de relation diglossique en Haïti plus ou moins ignorée par l’État. Mais, là encore, le bilan reste bien mitigé. Pour rendre compte, même de façon superficielle, du cas particulier de cette réforme et ses résultats dans les prochaines vingt années après son adoption, je veux citer une étude de M. Saint-Germain, Problématique linguistique en Haïti et réforme éducative : quelques constats publiée en 1997, soit dix-huit années après le début de la réforme Bernard. L’auteur a présenté un tableau panoramique des résultats de cette réforme en Haïti au cours de cette période. Mais malgré la tendance des recherches à enregistrer des gains pour le créole, dont l’une en 1995 mentionnée par M. Saint-Germain, il semble que la réforme a joué plutôt un rôle de catalyseur que de solution proprement dite :
[Cette] recherche menée en 1995 auprès de 75 adultes confirme l’avance du créole dans certains domaines. Plus de 96% des adultes interrogés ont reconnu qu’il y avait eu des changements dans les domaines d’utilisation des langues dans les dix dernières années. (…) Selon la majorité des répondants, le créole a fait des gains appréciables dans les secteurs du commerce (87,3%), de la vie culturelle (51,7%), de la radio (52,2%), de la vie politique (73%), de l’administration publique (62,1%), de la religion (77,8%). On note cependant certaines différences entre les groupes de répondants. Ainsi, 83,3% du groupe Université et 66,6% du groupe Enseignants considèrent que le créole a fait un gain appréciable dans le secteur de la vie culturelle alors que le français, selon ces groupes, en a peu fait (respectivement 16,7% et 33,3% des répondants). Le groupe d’adultes de Gonaïves se positionne différemment : 51,7% considèrent qu’il y a plus de français dans la vie culturelle alors que 34,5% estiment qu’il y a plus de créole. On retrouve cette même divergence dans le secteur télévision. Alors que pour les groupes Université et Enseignants, le créole a fait des gains appréciables (respectivement 61,5% et 85,7%), c’est le français qui aurait fait des gains pour le groupe de Gonaïves (53,1%) et le groupe PAP (53,8%). Pour ce qui est de la radio, selon 87,5% du groupe Enseignants, le créole y aurait fait un gain appréciable ; toutefois, cette position n’est pas partagée par les autres groupes…
Après avoir analysé les encombres de toute sorte qui ont entravé une issue satisfaisante de la mise en œuvre de la réforme Bernard, l’auteur a conclu :
Le jugement sur les langues du jeune Haïtien (tableau 7) est beaucoup plus partagé qu’il ne l’était en 1979. On note une considération bien moins grande à l’égard du créole et plus grande à l’égard de l’anglais et du français. Cette ambivalence envers les trois langues (créole, français et anglais) est aussi présente chez les adultes. On reconnaît la valeur du créole comme langue dans l’apprentissage ; on constate qu’il y a eu des gains considérables dans certains secteurs, dont la participation à la vie politique. En revanche, on est partagé quant à son importance relative par rapport au français et à l’anglais. Par ailleurs, les adultes considèrent maintenant que l’anglais est la langue la plus importante pour obtenir un bon travail.
On peut déceler le verdict final de l’auteur dans le résumé même de son article :
Une étude des données du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ne montre pas de gain éducatif depuis dix ans. La réforme, faute d’appuis pertinents, n’a pas atteint ses objectifs, notamment quantitatifs, même si elle a contribué au maintien d’une séquence de scolarisation normale. Chez les jeunes, la valorisation du créole n’est pas évidente malgré les acquis que la langue a enregistrés dans le domaine de la vie politique. (Saint-Germain, 1997).
M. Saint-Germain a en outre indiqué que les premiers progrès enregistrés auront beaucoup diminué après les bouleversements politiques de 1986, mais le processus de la réforme continue sous Jean-Bertrand Aristide qui, encouragé par le biais pro-créole du mouvement populaire, initie des campagnes d’alphabétisation en créole, mais en général la réforme continue avec la même lenteur et manque de vigueur comme par le passé.
Pour ceux qui considèrent l’haïtien comme une langue « inférieure » ou qui disent tout bonnement qu’il n’est pas une langue comme les autres, voire une langue proprement dite, on pourrait simplement leur référer aux études de N. Chomsky–en somme à toute la linguistique moderne–, qui attestent de l’égalité de compétence de toutes les langues du monde, la différence entre elles étant seulement une question de performance et de production. À ce propos, je voudrais citer ici un passage de l’ouvrage de D. Bickerton, Language and Human Behavior, qui envoie à la poubelle de telles foutaises :
S’il y avait un quelconque lien entre la complexité culturelle et la complexité linguistique, nous aurions espéré trouver que les plus complexes des sociétés aient les plus complexes des langues, et les plus simples sociétés les plus simples langues. Nous n’avons rien trouvé de cela. D’abord, personne n’a réussi à produire une métrique pour la simplicité linguistique. Si vous la mesurez par une certaine caractéristique, vous êtes réfuté par une autre. Si vous la mesurez par le nombre et la variété des inflexions, dans ce cas l’anglais et le chinois, les langues de deux des plus complexes cultures, s’avèrent extrêmement simples ; si vous regardez leur syntaxe, c’est une autre histoire. La simplicité d’un côté est toujours compensée par la complexité d’un autre côté. Quand vous prenez tous leurs aspects en considération, les langues sont à peu près égales en complexité. De plus, les langues étroitement liées qui ont une structure presqu’identique sont souvent trouvées dans les sociétés les plus complexes et les plus simples.
À ceux qui trouveraient cette assertion osée ou pas assez intelligible, Bickerton leur en étale le rationnel, avec de surcroît un langage plutôt simple :
Quiconque regarde de près une langue doit conclure que ses complexités sont ses propres complexités spéciales, sortant des sources qui sont très différentes du désir, de la conscience ou d’autre, pour rendre manipulables des cultures fort complexes. Donc, l’explication la plus plausible de ces complexités spéciales est qu’il y a des conditions imposées par le mécanisme qui les produit, suivant les travaux de l’organe qui est le seul rassembleur de phrases : le cerveau humain. Autrement dit, la langue est telle qu’elle est parce que c’est la seule façon dont le cerveau peut la faire. (Bickerton, 1995)
Il y a deux passages du livre de R.S. Édouard cité précédemment qui obligent à penser tous les responsables haïtiens concernés par la question de l’éducation, de l’enseignement et des inégalités sociales en général : « Considérant que toute forme de séparation de l’enfant de son milieu sociolinguistique est susceptible de produire des échecs pour lui, il est certain qu’un enseignement donné en créole produira des effets bénéfiques sur la scolarisation et le développement du capital humain des élèves haïtiens, bercés dans cette langue depuis leur naissance. » Un constat que la majorité des recherches sur le sujet viennent à souligner.
L’autre passage est lui aussi un constat sur les dégâts que le non-emploi de la langue maternelle dans l’enseignement a causés au pays, citant Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, R.S. Édouard a conclu : « Loin de réduire les inégalités sociales, l’école les intègre et est devenue le lieu de leur reproduction pour la simple raison que, “la structure des rapports de force exclut qu’une action pédagogique dominante puisse recourir à un travail pédagogique contraire aux intérêts des classes dominantes qui lui délèguent son autorité pédagogique” (Cf. Ibid. : 69). Dans une telle perspective, les enfants des classes dominantes sont les grands bénéficiaires de cette structure scolaire qu’on retrouve dans presque tous les pays, en particulier ceux en voie de développement tel qu’Haïti. »
Dans son livre Yon lekòl tèt anba pou yon peyi tèt anba, Y. Dejean a cité Hubert Devonich pour critiquer l’absence du créole ou plus précisément sa faible représentation–à la fois à l’oral et à l’écrit–dans l’éducation et dans les affaires sérieuses de l’État :
Tout moun bezwen konprann enpòtans lang kreyòl la nan tout pwoblèm Ayiti. Remak Devonish (1983–304) fè yo, gen anpil valè pou Ayiti : “Nou dwe aprann li, aprann ekri, devlope konesans yo nan divès branch. Men sa pa kont, sa pa gen sans si elèv pap kapab sèvi ak kreyòl pou aktivite y ap mennen nan peyi yo, nan sosyete yo, kote kreyòl dwe gen yon plas ofisyèl, sitou nan ekriti.” Gen 2 pwen enpòtan nan pawòl Devonich yo. 1) Se sèvi ak kreyòl kòm mwayen prensipal pou elèv lekòl aprann pi byen, sa vle di aprann li an kreyòl, aprann ekri an kreyòl, mennen aktivite lekti ak ekriti an kreyòl, etidye an kreyòl. 2) Se sèvi ak kreyòl kòm mwayen prensipal pou popilasyon an regle tout sa li gen pou li regle nan tout aktivite l kòm sitwayen ki jwenn papye leta an kreyòl, sèvis anplwaye biwo leta an kreyòl (Dejean, 2013: 383).
Le statut ou traitement de sa langue est fondamental pour la complétude existentielle de l’individu ; le sens de fierté d’être le dépositaire d’une langue respectée dans la société ambiante est une source de plaisir et de plénitude. La langue, en effet, c’est aussi la musique que vous entendez, votre manière particulière d’être, et mêmes vos préférences culinaires. Prenant J.A. Brillat-Savarin à témoin, R. Barthes a même osé avancer que « manger, parler, chanter (faut-il ajouter : embrasser ?) sont des opérations qui ont pour origine le même lieu du corps : langue coupée, et plus de goût ni de parole » (Barthes, 1984).
Il faut remarquer, toutefois, qu’en Haïti, le créole n’est pas tout à fait représenté dans aucune des deux catégories du discours ou d’idiolectes privilégiés par Barthes dans sa dualité langage encratique contre langage acratique, parce que tout simplement le créole n’y est pas reconnu comme langue légitime ; la langue de pouvoir qui a droit de cité dans la cité, c’est le français. Le créole est une sorte de langue-zombie, invisible et non représentée dans le lakou du bòkò.
3. Le bovarysme linguistique
Le bovarysme haïtien, dénoncé par Jean Price-Mars vers la fin des années 1920, a eu une nouvelle vie ces derniers temps. Édouard Glissant l’aura réhabilité pour en faire une identité multi-monde, investie à la fois du même et de l’autre, nourri, positivement, par tous les deux. Ainsi, il ne voyait aucun problème à écrire des œuvres magistrales, créolisantes, en français, alors qu’il n’avait rien publié en créole martiniquais, sa langue maternelle, dont il lamentait au moment même son éventuelle disparition.
Dans un essai de M. Dash, traduit par Marielle Macé sous le titre Ni français ni Sénégalais : une identité haïtienne et bovaryste, l’auteur semble faire l’apologie de la nouvelle vie du bovarysme. Tout d’abord, il fallait déshonorer le père du concept « bovarysme haïtien » (que Price-Mars avait emprunté de Jules de Gaultier dans sa description du complexe d’Emma Bovary, le personnage de Flaubert dans Madame Bovary). Citant, sans en questionner l’intention, la critique de Dany Laferrière dans Le cri des oiseaux fous, M. Dash lui donne le bras :
Les excès de brutalité du régime étaient le comble de la politique raciale du bovarysme marsiste. Laferrière avait le sentiment que la vraie tragédie des années 1960 résidait dans l’incapacité haïtienne de dépasser la vieille représentation d’une réclusion pastorale ; il en avait trouvé l’image dans l’édition en lambeaux d’Ainsi parla l’Oncle et la photo jaunie de Price-Mars qui trônaient dans le bureau du Petit samedi soir, le journal où il avait travaillé dans les années 1970. (Dash, 2012).
Il est vrai que le noirisme sanguinaire de François Duvalier et sa récupération du discours identitaire de Price-Mars avaient gravement amoindri la portée symbolique de la critique de celui-ci du bovarysme haïtien ; mais ça ne veut nullement dire que la critique elle-même était dépassée. En fait, si on analyse suivant la méthodologie de la psychanalyse freudienne les auteurs contemporains critiques de la critique de Price-Mars du bovarysme (Édouard Glissant, René Depestre et Dany Laferrière parmi les plus notables), on verra qu’ils ont en commun les points suivants : ils veulent tous tuer le père (Price-Mars) pour pouvoir avoir la voie libre d’épouser la mère (la France) et sa grande culture civilisante (la langue française), au mépris de leur langue maternelle (le créole) et leur culture ancestrale (le vodou). Naturellement, l’embrassade de la mère se révèlera d’autant plus ouverte et provocatrice qu’elle dissimule un sentiment de honte de soi et d’internalisation du mépris manifestée par la mère, dominatrice et insensible. Freud aurait beaucoup à dire en effet s’il devait analyser les multiples personnalités et les divers mondes revendiqués par Glissant, Depestre et Laferrière !
Comme on le sait, l’essentiel de la critique de Price-Mars du bovarysme se résume à ceux qui veuillent se faire paraître autres que ce qu’ils sont véritablement ; une disposition mentale qui encourage le mimétisme, l’auto-dévaluation et l’inauthenticité. Pourquoi ces auteurs en font-ils une vertu ? À ce propos–bien que non proprement relaté au bovarysme–, la réponse qu’a donnée E. Glissant à Gaston Miron quand il lui a demandé pourquoi il n’écrit pas en créole martiniquais–« C’est une question de génération : si j’avais vingt ans aujourd’hui [1995], je commencerais par écrire en créole…»–est bien indicative (Glissant, 1996: 53). Quinze ans plus tard, il n’aura toujours rien publié en créole martiniquais à ce que je sache. Le monolingue martiniquais, haïtien ou sénégalais n’ont pas l’option d’appartenir à plusieurs mondes ; leur monde est régulé par la routine oppressive des états de fait et des imprédictibilités de la contingence dans un monde singulier, leur monde, la localité du présent. J’ai remarqué, par observation empirique, que les monolingues haïtiens vivant aux États-Unis qui avaient souffert de la stigmatisation infériorisante du créole quand ils étaient en Haïti, souffrent aussi de leur déficit de l’anglais par une proportion plus élevée que leurs compatriotes bilingues (créole/français) vivant aussi aux États-Unis. L’impactisation de l’aliénation éducativo-linguistique transcende les frontières et les particularités linguistiques.
Je souscris volontiers à l’idée qu’Haïti, étant donné les circonstances particulières de son histoire et de sa contribution importante à notre modernité, mérite une réflexion qui l’insère dans la géopolitique globale (ou dans l’épistémè humaniste universelle), mais cette vision de l’appartenance universelle n’exclut pas la valorisation des caractéristiques particulières du peuple haïtien dont le créole, sa langue maternelle collective, est une part cruciale et indispensable.
Ce que Jean Price-Mars nomme bovarysme, je l’appellerais zombification : la mise en condition du gwobonnanj (le gros-bon-ange) des Haïtiens par la politique d’éducation pro-française et, surtout, par l’ostracisme linguistique du créole. C’est bien malheureux que Jean-Price Mars lui-même n’eût pas conçu la dimension linguistique de sa problématique bovaryste…
Dans Critique de la francophonie haïtienne, j’ai parlé de l’histoire d’Erfilia, semi-analphabète et monocréolophone, qui apprenait par cœur des bribes de phrases françaises, avec accent et tout, pour impressionner son amant, un étudiant de la médecine dentaire. Je pourrais tout aussi bien parler de Gentilhomme, un déséquilibré mental, qui récitait par cœur les drames de Corneille et de Racine et qui insistait à parler un français marron de son cru ; il nous amusait bien, nous autres du quartier, sachant que ses élucubrations linguistiques étaient causées par la pathologie de son état mental, qui ne l’empêchait pas cependant d’exhiber les préjugés anti-créoles appris depuis son jeune âge. Je pourrais tout aussi bien parler des plaisanteries qui révèlent comme punch line, ou trait risible final, l’ignorance d’un interlocuteur des règles de la grammaire française ou de ses prononciations. Je pourrais tout aussi bien citer les monocréolophones illettrés qui envoient des lettres–écrites en français en sous-main par un aide–à d’autres monocréolophones résidant à l’étranger. Ça paraitrait absurde seulement si on ignorait que presque tous les chefs d’État haïtiens s’adressent au peuple en français, sachant bien que c’est une toute petite minorité qui comprendrait leurs dires, une tradition dont seul Jean-Bertrand Aristide s’est démarqué dans quelques occasions.
Pourtant, les colons français savaient parfaitement bien que la langue du peuple était le créole et lui adressaient dans cette langue quand ils avaient quelque chose important à lui communiquer. Ainsi Napoléon Bonaparte avait-il fait en sorte que sa proclamation au peuple de Saint-Domingue à la veille de son invasion pour rétablir l’esclavage fût traduite en créole : il voulait qu’il comprenne bien l’objectif bénévole de son invasion annoncée, à savoir la défense de la liberté des habitants et anciens esclaves de l’île, donc un mensonge. Cette traduction de la proclamation montre que les envahisseurs n’étaient pas dupes de la prétention « francophone » des habitants de l’île que les élites colonisatrices promouvaient pour la dégustation de la métropole.
Je partage l’avis de Maximilien Laroche qu’avant l’acte de l’indépendance et l’emploi du français comme langue officielle de facto par le nouvel État haïtien en ce 1er janvier 1804, le sort du créole comme langue première n’était pas encore décidé. L’acte officiel de Boisrond Tonnerre, héros incendiaire et vénéré de la bravoure révolutionnaire du nouvel État haïtien, a scellé et confirmé le choix de la francité comme sa langue et culture d’appartenance et d’expression. Le bovarysme avant la lettre s’est donné des couleurs officielles. À vrai dire, en 1804 et avant, le créole n’était pas considéré comme une expression linguistique légitime, bien qu’il fût déjà parlé par la majorité des habitants de la partie occidentale de l’île.
4. Les petits pas vers une nouvelle épistémè
En dépit d’une longue tradition de nos écrivains d’insérer des phrases courtes créoles dans les grandes œuvres littéraires françaises (une tradition qui parcourait tous les xixè et xxè siècles et coquettement appelée incrustation) ; en dépit des efforts des frères Ignace et Émile Nau au xixe siècle pour incorporer le créole dans la grande littérature romanesque, on peut faire remonter le changement d’attitude radical de l’intelligentsia francophile vers une position pro-créole reconnaissant à la fois la compétence, la scientificité et la légitimité de cette langue, au demi-siècle qui va des années 1950 aux années 2000, avec les influences combinées de Félix Morisseau-Leroy, Pradel Pompilus, Frankétienne, Konpè Filo, Languichatte Débordus (Théodore Baubrun), Jean-Claude Martineau (Koralen), etc. À ce propos, des chercheurs comme Charles-Fernand Pressoir, Frank Laubach, Ormonde McConnell, Lélio Faublas, méritent une mention spéciale pour avoir contribué à la réflexion et l’action, voire à l’élaboration de la graphie moderne du créole haïtien.
Cependant, la vague de militantisme linguistique qui a vu l’émergence d’une pensée active et activante de la problématique du créole, impulsée par des figures inculquées de la haute culture française tels Yves Dejean, Pierre Vernet, Suze Mathieu, Frenand Léger, Renauld Govain, Max Manigat, Pauris Jean-Baptiste, Michel DeGraff, etc., est un phénomène plus récent. Cette tendance trouvera son heure de gloire avec l’organisation du « Kolòk entènasyonal sou Akademi Kreyòl Ayisyen » (Colloque international sur l’Académie du créole haïtien), tenu à Port-au-Prince du 26 au 29 octobre 2011, sous le leadership décisif du vice-recteur à la recherche d’alors (aujourd’hui recteur) de l’Université d’État d’Haïti, Fritz Deshommes. Le colloque dont les actes seront publiés en un recueil de textes sous le titre Akademi Kreyòl Ayisyen : Ki pwoblèm ? Ki avantaj ? Ki defi ? Ki avni ? prouve l’emploi du créole à un niveau académique et scientifique élevé ; il a été à la fois le catalyseur et le guide de l’initiative citoyenne pour fonder l’Akademi Ayisyen. La grande qualité intellectuelle des essais de cette anthologie de 440 pages, dont les 9/10e de textes sont écrits en créole haïtien, est un témoignage que ceux qui doutent encore de la capacité ou légitimité du créole comme langue nationale, à compétence comparable à toutes les autres langues nationales du monde, sont motivés non pas par des considérations linguistiques ou académiques, mais plutôt par des préjugés idéologiques.
À la fois la tenue du colloque, les intellectuels qui y ont contribué et l’influence considérable qu’il a eu dans le débat sur la valorisation du créole participent de ces grands événements de la vie de la nation qui placent son destin dans une lueur plus favorable. En effet, l’appel qu’avait lancé Fritz Deshommes durant le xiiè Colloque international sur les études créoles, tenu en Haïti du 25 au 29 octobre 2008, avait suscité un regain d’intérêt dans le projet de l’Académie du créole, le statut de celui-ci en tant que langue-zombie ayant été encore une fois mis à l’index. L’appel de Deshommes a eu un effet contagieux qui a abouti à l’organisation du colloque, puis du « Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen » (Comité préparatif de l’Académie du créole haïtien), et finalement au fondement de l’Akademi Ayisyen lui-même.
Dans son introduction des actes du colloque, R. Govain a souligné que le « débat sur l’utilisation du créole dans l’éducation en Haïti a commencé avant 1979. Georges Sylvain, en 1898, avait estimé que si l’on introduisait le créole dans les écoles du pays, le système aurait fait un grand pas en avant ». Le colloque lui-même était une initiative bien audacieuse et ambitieuse qui mobilisa une part considérable des milieux intellectuels du pays et de la diaspora.
Est-ce une académie de langue nécessaire ? J’étais longtemps éclairé de l’argument qu’une académie est souvent plus nuisible que bénéfique à une langue ; on aime citer l’exemple de l’Académie française qui a été admirée plus comme relique d’une certaine idée de la France et du français que comme juge intellectuel ou grammairien d’envergure. Mais, ces critiques–que ce soit dans le cas de l’Académie française ou dans celui de l’Akademi Kreyòl Ayisyen–n’appréhendent pas la raison fondamentale qui les a rendues nécessaires dans leur temps respectif. Ces critiques ont failli comprendre combien la valeur du référent identitaire importe dans une dynamique de domination et d’oppression où la langue de l’individu est infériorisée, ostracisée, dévaluée sur le boulevard social. En effet, dans les rapports de pouvoir entre le latin, langue des clercs et des puissants, fleuron sur plusieurs siècles de la domination politique, économique, militaire et intellectuelle de Rome, et du français, langue des masses, pour la plupart incultes, il y avait ce que les Étatsuniens appellent une « imbalance », un déséquilibre de forces. Le cardinal Richelieu savait bien qu’en établissant l’Académie française sous l’égide de l’État, il mettait du coup la puissance de l’État impérial au service de la langue du pays dont il se sentait le serviteur. Il était motivé par des considérations non nécessairement linguistiques, mais plutôt par une certaine idée qu’il avait de l’empire français émergent, sachant bien que dans un pays où la langue est infériorisée, la force de l’Était peut constituer un atout d’une importance capitale, cela d’autant plus que la langue peut constituer un bon instrument de contrôle des autres peuples.
Dans ma contribution aux actes du colloque d’octobre 2011, il y a un intertitre que j’ai nommé « Akademi Ayisyen : Jefò pou yon nouvo epistèm » dans lequel j’ai écrit ceci :
Akademi Ayisyen : Jefò pou yon nouvo epistèm. Yon Akademi Ayisyen, Leta ak sosyete sivil la ansanm ak gwoup aktivis kiltirèl oswa sitwayen aktif pran angajman pou yo soutni, ka jwe yon wòl desizif nan jefò valorizasyon lang ayisyen an, epitou nan jefò pou kreye yon nouvo epistèm ki renvèse sistèm valorizasyon ki koumanse depi sou lakoloni an e ki benefisye sèten klas sosyal e ki ankouraje lakay pèp la jakorepetisyon, rayisman pwòp tèt yo e asimilasyon devandèyè ak yon sistèm lengwistik etranje ki zonbifye idantite palan ayisyen yo. Se pou tout rezon sa yo, mwen rele pou tablisman yon nouvo epistèm, sètadi yon nouvo lòd valè, yon nouvo sistèm panse, sistèm kwayans e sistèm ajisman ki valorize pwodiksyon entelektyèl e atistik nan lang ayisyen an (Tontongi, 2013: 400)
5. Conclusion
Je soutiendrai qu’il y a une causalité empirique entre d’une part les brimades historiques de la part du colonialisme et de l’impérialisme occidentaux, l’exclusion sociale, l’exploitation de classe, la zombification culturelle et la dévaluation de la langue du peuple, et, d’autre part, le sous-développement, la pauvreté et l’involution dépendancielle d’Haïti. C’est une chaîne indubitable de calamités et de répétitions.
On comprend bien que la dimension dévastatrice du signifiant insidieux de la problématique langagière n’est guère évidente à première vue, spécialement pour ceux-là qui en sont bénéficiaires. Nous espérons bien qu’avec l’engagement de tous ceux qui en sont concernés, y compris l’intelligentsia francophile dont beaucoup de membres sont aujourd’hui gagnés à la cause de la libération langagière en Haïti, et aussi avec la participation des écrivains, des créateurs, des enseignants et des scientifiques, nous arriverons un jour à démêler ce nœud gordien et changer de cap dans le sens du redressement historique. Rien de moins ne satisfera cette vision.
Naturellement, la solution saute aux yeux : la nécessité d’une politique de libération totale qui prenne en considération le facteur linguistique, c’est-à-dire l’importance de la langue du peuple comme à la fois génératrice de développement économique et de complétude existentielle.
Éventuellement, pour matérialiser le rêve et l’exigence de revalorisation du créole comme langue première et principale de la nation haïtienne, il faudra l’avènement au pouvoir d’un gouvernement progressiste et démocratique qui reconnaisse qu’il n’y a rien de plus démocratique que la restitution au peuple haïtien–à la fois de jure et de facto–, son droit à la parole et à l’éducation dans sa langue maternelle, et à tous les niveaux du savoir et de l’enseignement.
Je demeure certain qu’une telle prise d’engagement de la part de l’État déclenchera un effet favorable dans toute la société et dans l’entendement des Haïtiens et des Haïtiennes, qui découvriront, qu’après tout, leur langue est une langue totale-capitale et légitime, à l’instar de toutes les langues du monde.
—Tontongi octobre 2017.
6. Bibliographie
Barthes, Roland (1984), Le bruissement de la langue, Essais critiques IV. Paris, Seuil.
Berrouët-Oriol, Robert (2016), Le refoulement des langues officielles d’Haïti dans une grande conférence caribéenne, Montray Kreyòl du 5 juillet 2016.
Berrouët-Oriol, Robert (2017a) L’État haïtien et la question linguistique : timides mutations, grands défis, Le National, 16 août 2017.
Berrouët-Oriol, Robert (2017b) Faut-il exclure le français de l’aménagement linguistique en Haïti ?, Potomitan, 20 août 2017.
Bickerton, Derek (1995), Language and Human Behavior. University of Washington Press.
Bourdieu, Pierre et Passeron Jean-Claude (1970), La reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement. Paris, Minuit.
Dash, Michael (2012) « Ni français ni Sénégalais : une identité haïtienne et bovaryste », traduit de l’anglais par Marielle Macé, Revue Fabula LHT.
DeGraff, Michel (2013) « Men anpil, chay pa lou : an nou sèvi ak lang kreyòl la pou bonjan edikasyon ak rechèch ann Ayiti ». Dans R. Govain (dir.), Akademi Kreyòl Ayisyen : Ki pwoblèm ? Ki avantaj ? Ki defi ? Ki avni ? Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 133–165.
Dejan, Iv (2013), Yon lekòl tèt anba pou yon peyi tèt anba. Port-au-Prince, Éditions de l’Université d’État d’Haïti.
Edouard, René Saurel (2017), Éducation, capital humain et développement social par le créole en Haïti. Paris, L’Harmattan.
Glissant, Édouard (1996), Introduction à une poétique du divers. Paris, Gallimard.
Govain, Renauld (2005), Pour une politique linguistique en Haïti aujourd’hui, Le Nouvelliste, 29 juillet 2005, reproduit en septembre 2017
Métraux, Alfred (1958), Le Vaudou haïtien. Paris, Gallimard.
Saint-Germain, Michel (1997), Problématique linguistique en Haïti et réforme éducative : quelques constats, Revue des sciences de l’éducation, 23(3), 611–642.
Schaff, Adam (1964), Langage et connaissance. Paris, Anthropos.
St Fort, Hugues, Berrouët-Oriol, Robert (2017), La question linguistique haïtienne / Textes choisis. Port-au-Prince, Zémès.
Tontongi (2014), Sèl pou dezonbifye Bouki, Éditions Trilingual Press, 2014.
Tontongi (2013) « Nesesite ak idantite : bezwen pou pwodiksyon ekritoryèl nan lang ayisyen ». Dans R. Govain (dir.), Akademi Kreyòl Ayisyen : Ki pwoblèm ? Ki avantaj ? Ki defi ? Ki avni ? Port-au-Prince, Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 389–405.
Tontongi (2007), Critique de la francophonie haïtienne. Paris, L’Harmattan.
Le livre collectif La francophonie haïtienne et la francophonie internationale : apports d’Haïti et du français haïtien, peut être obtenu sur le site de JEBCA Éditions.
Notes
| 1. | Les réactions reportées ici sont la reproduction française abrégée des courriels créoles envoyés par les personnes citées aux administrateurs du colloque. J’étais très satisfait que l’UEH reconnût de sitôt l’erreur et la rectifiât promptement. |
| 2. | Note de l’auteur : Mais cette part de la culture française n’est plus vue en tant que telle car elle a été transformée dans le moule des patterns culturels locaux. Toute culture, en fait, est faite d’adoption mais surtout d’adaptation d’éléments empruntés à d’autres cultures. |
| 3. | Note de l’auteur : Ces outils didactiques ont été soit importés de France, soit élaborés par les Français eux-mêmes sans le moindre souci d’une contextualisation didactique pour être conformes aux spécificités du milieu. Par exemple, il est enseigné aujourd’hui encore aux apprenants haïtiens qu’il y a quatre saisons (printemps, été, automne, hiver) ! Ils nous ont imposé une éducation à leur manière, selon leur imaginaire de Français et cela entre en contraste avec le naturel qui nous caractérise. Et cette tradition de non-contextualisation didactique se poursuit encore car la prise de conscience de cette nécessité n’est guère encore une réalité en Haïti… |
